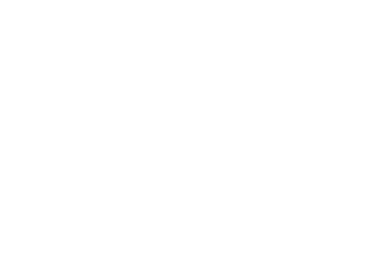Article paru sur les Inrockuptibles le 11 avril 2019. Lien : Artcile Inrockuptibles.
Interview de Goundo Diawara - Rixes entre quartiers : “Un enfant ne tombe jamais dans la violence pour rien”
Assa Traoré, rédactrice en cheffe des “Inrocks” cette semaine, a souhaité mettre en lumière les conflits inter-quartiers et leurs jeunes victimes, dont les causes sont rarement interrogées sérieusement.
La liste des victimes des violences inter-quartiers n’existe pas. Leurs noms apparaissent sporadiquement dans la presse, puis disparaissent la plupart du temps tout de suite après de la mémoire collective. Plus encore que les violences policières, les conflits qui opposent des bandes de jeunes de quartiers rivaux passent sous les radars, sont traités uniquement sous l’angle du fait divers, ou sont utilisés avec démagogie par certains responsables politiques. Pour mettre en lumière cette situation, ses causes et les moyens d’enrayer cette spirale mortifère, nous avons interrogé Goundo Diawara. Âgée de trente ans, cette conseillère principale d’éducation (CPE) dans un collège du Val d’Oise et membre du Front de mères, le premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires, appelle à traiter cette question “en dehors du lieu commun qui consiste à dire qu’on va augmenter les effectifs de policiers”.
On entend régulièrement parler des violences inter-quartiers suite à des bagarres entre jeunes, mais on en interroge rarement les causes profondes. De votre point de vue, la situation s’est-elle aggravée ces dernières années ?
Goundo Diawara – C’est une problématique qui existe depuis trente ou quarante ans dans ces quartiers populaires. Dans mon enfance, on en parlait déjà. Ce qui a évolué, c’est la “communication” qui est faite dessus. Moi qui travaille avec des jeunes, j’observe depuis des années le glissement qui s’opère dans l’utilisation des réseaux sociaux qui peuvent à la fois servir d’outils “cool”, qui créent du lien, et d’outils “destructeurs”. Sur les violences inter-quartiers, je vois bien que certains utilisent ces réseaux pour se donner rendez-vous pour aller se battre. Ensuite, il existe une sorte de publicité de ces bagarres qui, lorsqu’elles sont filmées, circulent indéfiniment de ville en ville, créant parfois un effet de surenchère : quand un jeune se fait frapper plus fort que les autres, on le considère comme humilié, son quartier réplique, et c’est sans fin. Ceci étant, le phénomène en lui-même n’a malheureusement rien de nouveau. Mais il y a des périodes où, sans explication rationnelle, on en entend parler davantage parce que les rixes se multiplient, comme l’automne dernier où il y a eu trois morts en quelques jours (dont 2 en 24h) : Henry, 17 ans, tué dans le XIXe arrondissement de Paris ; Fodie, 17 ans, tué à Sarcelles ; et Aboubakar, 13 ans, tué aux Lilas.
Quels sont les motifs de ces décès ?
Ce sont des conflits différents, dans trois territoires différents. On parle toujours de “rixes” entre bandes de quartiers, parce qu’on sait que ces enjeux sont souvent présents. Mais la réalité est parfois loin de ces représentations. Fodie par exemple, aurait été tabassé parce que des jeunes de son quartier auraient pensé qu’il avait dénoncé des actes. Mais Fodie ne faisait absolument pas partie d’une bande, et n’était dans aucune bagarre. C’est un lycéen qui a été tué en sortant de chez lui.
Pour le cas du jeune Aboubakar, originaire de Bagnolet, il était effectivement avec des copains lorsqu’une bagarre a éclaté, mais il n’est pas avéré qu’il faisait partie d’une bande à proprement parler. D’autres jeunes se font tuer parce qu’ils prennent part activement à des bagarres. C’est le cas par exemple d’un jeune du XIXe arrondissement qui, nourri par la douleur de la perte de son propre frère tué un an avant, mais aussi par une certaine volonté de vengeance, a pris part à une bagarre durant laquelle il a été tué, en septembre 2017. Toutes ces histoires ne peuvent pas être associées, mais le contexte reste celui de rivalités inter-quartiers.
Arrive-t-il souvent que des jeunes meurent alors qu’ils sont complètement extérieurs à ces rivalités ?
Oui, assez régulièrement. Je peux en attester de façon personnelle : un de mes grands-frères s’est fait tirer dessus lorsque j’avais dix ans. Il sortait de chez mes parents pour accompagner un ami, dans un contexte assez tendu de conflits entre notre quartier et celui d’une ville voisine. Il y a eu une “descente” de jeunes de cet autre quartier, qui sont alors tombés sur mon frère et d’autres amis et ils ont tiré dans le tas. Dieu merci il n’est pas décédé, mais concrètement, ce qui a fait de lui une cible est le simple fait d’être identifié comme venant de tel quartier. C’était il y a vingt ans, et c’est toujours pareil aujourd’hui. Être identifié comme venant d’un quartier considéré comme rival, suffit à faire naître le risque d’être malheureusement agressé. Il y a deux mois à Saint-Denis, fin février, un jeune du quartier Allende passait par là et on lui est tombé dessus. Il ne faisait pas partie d’une bande, mais a été roué de coups et a fini dans le coma.
Les réseaux sociaux jouent-ils un rôle selon vous dans cet effet d’engrenage ?
Engrenage, je ne sais pas. Mais il y a une curiosité malsaine qui amène d’autres jeunes, qui ne sont pas forcément dans cette logique de violence, à presque fantasmer ces bagarres. J’ai appris il y a peu de temps qu’il y avait par exemple beaucoup de vidéos de bagarres sur YouTube. Je ne pensais pas qu’elles faisaient beaucoup de vues, mais si ! Cela étant, je ne pense pas que visionner une vidéo suffise pour qu’un jeune plonge dans la violence, mais cela participe sans aucun doute à sa banalisation. La vidéo d’un jeune garçon lynché à Garges-Lès-Gonesse en septembre 2018 a énormément tournée, elle était sur tous les téléphones. C’est devenu une info comme une autre, alors que ce sont des images extrêmement choquantes ! Ce n’est cependant pas propre aux jeunes de quartiers populaires. Dans la société de manière générale, il y a une mise en scène problématique voire une glorification de la violence, dans les contenus télévisuels ou musicaux : il ne serait donc pas intellectuellement honnête de dire que ces jeunes sont responsables de sa banalisation.
Quels effets ces violences ont-elles sur les établissements scolaires ? Sont-ils directement touchés ?
C’est très aléatoire. Il y a des quartiers dans lesquels les établissements scolaires sont malheureusement en plein cœur de tout ça, avec des phénomènes d’intrusion dans les établissements pour en découdre. Je travaille dans un établissement qui se trouve en plein cœur d’un quartier extrêmement défavorisé, mais qui est relativement préservé de ce type de violence. En revanche ça se joue énormément à l’extérieur. A ce titre, j’estime que les établissements scolaires devraient avoir leur carte à jouer dans la prévention et l’accompagnement des jeunes qui connaissent des personnes agressées ou décédées dans leur quartier, car notre responsabilité est aussi engagée. En tant que CPE je suis assez effarée que l’Éducation nationale ne pense pas suffisamment la nécessité de prendre en compte cette question.
Par exemple, après une situation comme celle du lynchage du jeune de Garges l’an dernier, il me semble indispensable que soit banalisée une heure dans les établissements alentours pour en discuter, car on sait que nos élèves ont vu ces images d’une violence inouïe. C’est ce que nous avons fait dans mon collège, mais ce n’est clairement pas le cas partout. De manière générale, on met des œillères, considérant que la violence est extérieure. Pire encore, on fait comme si cela ne pouvait pas avoir de conséquences chez nos élèves : après le décès d’Henry en octobre dernier par exemple, ses camarades lycéens n’ont pas ou peu été accompagnés. L’un de ses meilleurs amis est passé en conseil de discipline peu de temps après, pour d’autres raisons, mais à aucun moment on s’est dit que ce jeune qui faisait face au décès de son ami était dans la transgression parce qu’il était en souffrance.
Or cette violence a forcément des conséquences, elle touche nos enfants, nos élèves. Il serait de notre devoir de mettre en place des cellules d’écoute avec des professionnels formés pour mettre des mots sur tout ça. Parce qu’en parler, avec des adultes, c’est aussi faire en sorte que ces violences gardent leur caractère exceptionnel et malheureux.
Au niveau médiatique, on traite souvent ces affaires sous l’angle du fait divers, sans vraiment questionner ce qui les provoque structurellement. Quelles sont les causes de ce phénomène selon vous ?
C’est difficile d’avoir une expertise sur le sujet. Mais d’après les travaux scientifiques existants, comme ceux du sociologue Marwan Mohammed, et son livre La formation des bandes, on sait que le désœuvrement, l’errance, participent à générer ce type de comportements. Si tous les jeunes en rupture scolaire ne sont pas dans des bandes, il est avéré que tous les enfants qui fréquentent des bandes sont quant à eux en rupture scolaire, expliquant en partie les choses. Il y a également un manque d’entre-connaissance : ces jeunes ne se connaissent pas, même lorsqu’ils grandissent dans les mêmes villes et ont les mêmes codes, les quartiers sont très enclavés. Quand on connait ces données, on sait dans quelle direction travailler. Le fait de se constituer en groupe, en bande, c’est aussi pour eux une manière de faire face collectivement aux humiliations des institutions (police, justice, parfois école). Ils ont un sentiment d’exclusion.
La journaliste au Parisien Maïram Guissé, a écrit un article sur Garges-Lès-Gonesse en janvier, dans lequel elle laissait la parole aux jeunes qui participent aux rixes. Ils disent qu’au départ ils le font pour s’amuser, pour passer le temps, car leur quotidien c’est la galère, le désœuvrement – sans pour autant exclure le coté absurde de ces embrouilles. Dans ce patelin, les jeunes disent qu’ils ont l’impression de n’être les bienvenus nulle part. Ils se battent parce qu’il est question de faire bloc avec leurs frères de galère.
Que pensez-vous du traitement politique de ces affaires ?
Je suis toujours assez consternée par la façon dont ces affaires sont traitées la plupart du temps par les médias ou les politiques. Ces derniers associent assez facilement la mort d’un enfant des quartiers populaires avec son supposé casier judiciaire, comme si ceci expliquait cela. Faire un parallèle entre ces deux informations, c’est déjà plaquer une grille de lecture sur ce phénomène : quelque part, c’est une façon de dire des jeunes qui meurent dans ces rixes qu’ils l’ont cherché, voire mérité. C’est affligeant car ces jeunes finissent par être systématiquement perçus comme de potentiels délinquants, de la vermine, des parasites, et pas comme des enfants que la violence a happés. On se moque du fait qu’ils s’entretuent. C’est terrible. Je travaille dans un collège de 650 élèves, et je sais qu’un enfant ne tombe jamais dans la violence pour rien. Les trajectoires familiales, les conditions de vie, les injustices, la précarité sociale, les violences institutionnelles, tous ces éléments constituent des causes potentielles qui doivent d’une part éliminer le discours qui consiste à dire que la violence serait « naturelle » chez ces jeunes pour expliquer ces rixes, et d’autre part nous conduire à travailler sur une plus grande justice sociale.
Y a-t-il des moyens, des organisations, pour les familles et leurs enfants, de lutter ?
Je coordonne pour le Front de mères une démarche régionale de lutte contre les violences inter-quartiers, en collaboration avec plusieurs associations franciliennes qui travaillent d’arrache pied localement depuis des années sur cette problématique. Je fais partie des militants qui se sont légitimement beaucoup tournés vers les violences institutionnelles, mais malheureusement cela a été beaucoup trop exclusif. On travaille désormais avec ces organisations franciliennes sur la mise en place un plan d’actions qui permettrait de travailler sur l’apaisement de nos quartiers et de s’en réapproprier les espaces, dont l’Etat et ses services se sont désengagés. Il s’agit de s’auto-organiser pour littéralement sauver des vies en mobilisant les jeunes autour d’activités positives, valorisantes et qui les tournent vers l’avenir.
Nous souhaitons faire émerger un discours politique fort sur ce sujet car la responsabilité sur cette problématique est partagée. On entend beaucoup trop souvent que c’est de la faute des parents, mais il y a aussi des responsabilités institutionnelles. Ces jeunes n’ont plus droit à de nombreux services, ne jouissent pas des mêmes droits qu’ailleurs, d’où un fort sentiment d’exclusion. Notre discours politique se distingue clairement des prises de position assez démagogiques et même racistes qui existent depuis toujours à propos des rixes et qui nourrissent la stigmatisation. Nous souhaitons imposer cette question dans le débat public pour que les politiques s’en saisissent et exigeons que cette question soit traitée en dehors du lieu commun qui consiste à dire qu’on va augmenter les effectifs de policiers. On ne dit pas que ça ne sert à rien, mais face à ces violences, ce n’est pas le “plus de police” qui va régler les choses. D’autant plus que la police est malheureusement bien souvent la mère de nombre de violences dans ces quartiers où la répression n’a jamais cessé.
En définitive, il s’agira pour chacun, en tant qu’institutions, éducateurs, parents, responsables associatifs, de prendre ses responsabilités et de travailler sur des solutions concrètes en gardant bien en mémoire que les derniers à être responsables de toute cette violence sont les jeunes eux-mêmes.
Propos recueillis par Mathieu Dejean (Inrockuptibles)
Article paru sur les Inrockuptibles le 11 avril 2019. Lien : Artcile Inrockuptibles.